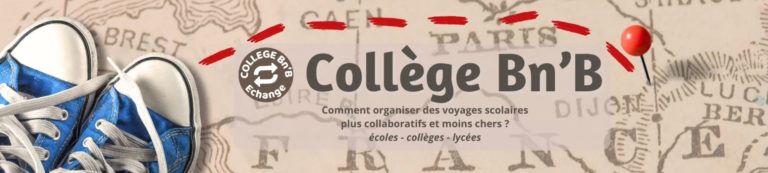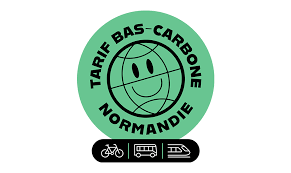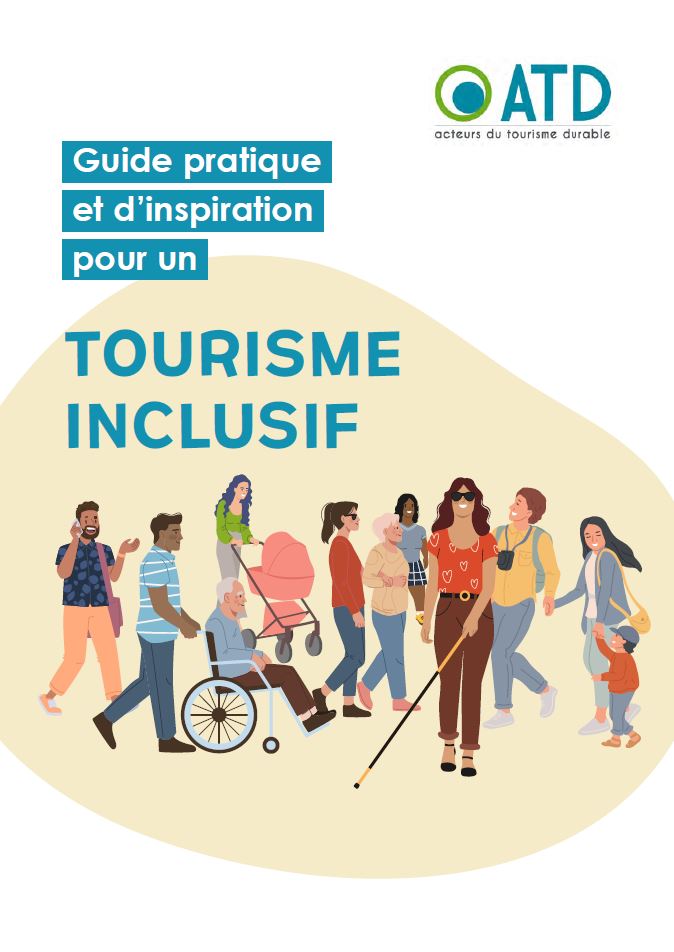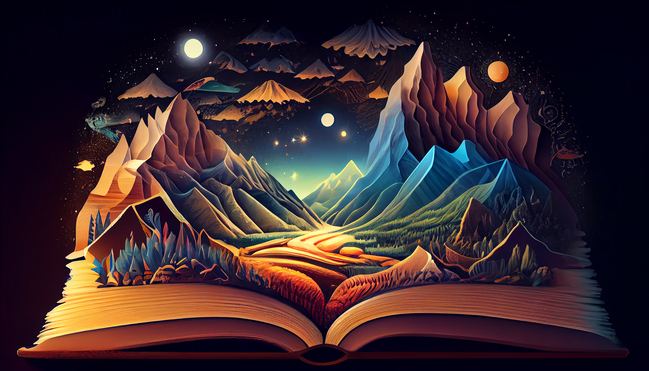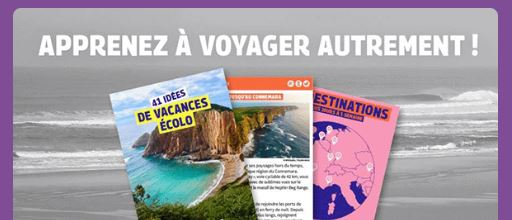C’est bientôt l’été, parlons régime (et diversification) !
En moyenne montagne, l’enneigement nous met au régime. Un coup il y a de la neige, un coup plus rien. Et à force de faire le yoyo, les stations finissent à bout de souffle, à guetter le moindre flocon comme d’autres guettent le retour du gras dans leur assiette.
La faute au changement climatique qui fait fondre l’or blanc et, avec lui, l’économie locale. Alors, pour éviter que les stations ne se transforment en triste souvenir, certains prônent pour une large diversification des activités à l’année. Cependant, cette stratégie est loin de faire l’unanimité et soulève des interrogations quant à sa pertinence, sa durabilité et son impact environnemental.
Une diversification coûteuse et incertaine
Pump track, accrobranche, luge sur rail, plan d’eau, centre de bien-être… Il y en aurait pour tous les goûts. Mais à quel prix ? Certaines communes, déjà mises au régime forcé côté budget, se voient débourser des sommes folles pour ces équipements. Et le retour sur investissement ? Flou, très flou.
« Sur les territoires, les actions de diversification mises en œuvre sont rarement adossées à un véritable projet. Réalisées au fil de l’eau, elles tendent souvent à reproduire le modèle du ski, fondé sur des investissements importants et une forte fréquentation, sans plan d’affaires permettant d’établir leur pertinence économique. » – Extrait du rapport de la Cour des Comptes (février 2024).
Si certaines stations parviennent à attirer une clientèle estivale, les chiffres de fréquentation restent très loin des pics hivernaux des belles années. Miser sur eux pour rentabiliser les nouvelles infrastructures, c’est comme croire qu’un régime express va vous faire rentrer dans vos vêtements d’adolescent après trois jours de monodiète. L’illusion est belle, le retour à la réalité beaucoup moins.
Quelques chiffres
L’hiver 2022/2023, en Savoie Mont Blanc, a généré 39,3 millions de nuitées contre 23,5 millions pour l’été 2023.
L’année suivante en stations de montagne, la saison été 2024 enregistre un taux d’occupation moyen sur la base des hébergeurs marchands en passerelle G2A (essentiellement situé dans Alpes du Nord) de 41,1% contre 65,4% pour la saison hivernale 2024/2025.
De plus, les touristes veulent du naturel, du vrai. En effet, les clientèles sont de plus en plus sensibles aux enjeux environnementaux et certaines activités peuvent apparaître en contradiction avec ces attentes. La diversification ne doit donc pas se faire au détriment de l’image écoresponsable que ces territoires souhaitent promouvoir.
En témoignent par exemple les sept préoccupations majeures au cœur des enjeux « Quelle montagne en 2030 ? » exprimées lors de la restitution de la grande enquête citoyenne menée par Mountain Wilderness (26 mai dernier).
- L’accélération de la transition vers un tourisme plus durable
- La protection et la restauration des écosystèmes naturels
- L’arrêt de nouvelles constructions touristiques et la réhabilitation de l’existant
- Le soutien à la diversification de l’économie locale
- La sensibilisation du public à la nature et aux pratiques touristiques responsables
- Le développement des mobilités durables et en particulier le ferroviaire
- L’implication citoyenne dans la fabrique des politiques publiques
Des conditions naturelles limitées
Le principal obstacle à une diversification réussie repose sur les conditions naturelles inhérentes aux territoires de moyenne montagne. En hiver, le manque de neige rend le ski impraticable, mais les activités estivales ne sont pas non plus sans contraintes. Les épisodes de canicule et les risques de sécheresse impactent directement les activités de plein air.
A titre d’exemple, les touristes dépensent plus d’un milliard d’euros en Ardèche chaque année, mais le climat pourrait devenir un handicap. Ainsi, l’on entend « Si il y avait moins de touristes, on aurait un peu plus d’eau » ou encore « La canicule devient un handicap pour des touristes qui ont eu trop chaud lors de leur séjour ou ont été « attaqués » par des hordes de moustiques. » – Sources articles ICI, ex France Bleue.
Par ailleurs, les initiatives d’envergures, comme la construction de plan d’eau, soulèvent des problématiques environnementales majeures : consommation d’eau dans des zones souvent touchées par le manque (sécheresse, nature des sols) ou tout simplement la consommation d’espace naturel sur ces territoires reconnus pour leur cadre exceptionnel (paysages, milieux atypiques, espèces emblématiques, etc.). Ces infrastructures apparaissent comme une solution à court terme, mais elles peuvent aggraver les effets du changement climatique à long terme.
L’enjeu n’est pas de trouver une recette magique mais d’apprendre l’équilibre.
Et si on pensait local et humain ?
Plutôt que de courir après les dernières activités à la mode, pourquoi ne pas miser sur le local et l’humain ? Les pistes ne manquent pas pour attirer une clientèle (ou de nouveaux habitants) en quête d’authenticité. Mais cela demande une vraie réflexion et, surtout, des efforts. Se mobiliser à long terme, apprendre à travailler ensemble, penser collectif, expérimenter en considérant les erreurs possibles, communiquer efficacement et largement, mesurer les effets des initiatives prises, évoluer par des actions concrètes, etc. Pour que la transition soit réussie, la montagne doit se réinventer sans chercher à reproduire le modèle du ski. La transition doit être durable et résiliente, en phase avec les réalités climatiques et sociétales.
Quelques exemples
La marque « Je Vois la Vie en Vosges », portée par le Conseil départemental, valorise l’identité vosgienne en s’appuyant sur une économie durable, une culture riche et un mode de vie en harmonie avec la nature, tout en soutenant les acteurs locaux pour renforcer l’attractivité du territoire.
À Gérardmer, la « perle des Vosges », on mise sur les savoir-faire textiles, forestiers et gastronomiques. À la Bresse, première station de ski du massif, on met en valeur les fermes-auberges, le patrimoine vosgien, les hébergements typiques et le Parc naturel régional.
Leurs modèles économiques reposent notamment sur des événements fédérateurs, la structuration et la gestion de pratiques plébiscités par un large public (randonnée, vélo et trail) mais également de fortes synergies public/privé autour d’un tourisme familial et nature.
Du rêve au pragmatisme : la diversification, un ingrédient, pas le plat principal
En fin de compte, la diversification n’est pas un régime mais un ingrédient dans un menu bien plus complexe. À elle seule, elle ne suffit pas à rassasier les ambitions des territoires ni à compenser les carences du modèle économique actuel. Mieux vaut éviter les recettes miracles et privilégier les bons produits locaux, mijotés avec patience et lucidité.
« La montagne, ça vous gagne », disait le slogan. Oui, mais encore faut-il savoir avec quel menu on compte la nourrir. À trop gober des solutions toutes prêtes, on risque surtout l’indigestion.